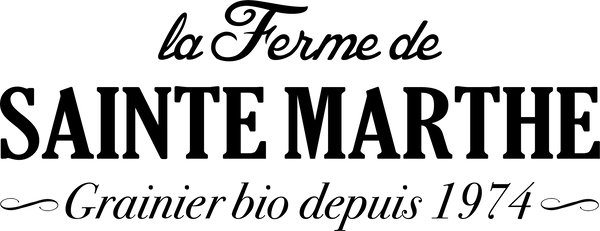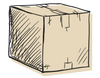Comment lutter contre l'oïdium ?
L’oïdium, aussi appelé « maladie du blanc », est une affection fongique bien connue des jardiniers. Facilement reconnaissable à son feutrage blanc sur les feuilles, il peut rapidement affaiblir les plantes et compromettre les récoltes. Ce champignon microscopique touche un très grand nombre d’espèces potagères, fruitières et ornementales. Pour mieux le prévenir et s’en débarrasser, il est essentiel de comprendre son fonctionnement, les conditions qui favorisent sa propagation, ainsi que les moyens de lutte efficaces.
Sommaire de l'article
Qu’est-ce que l’oïdium ?
L’oïdium est une maladie provoquée par plusieurs champignons microscopiques appartenant à des genres différents, parmi lesquels Erysiphe, Uncinula, Sphaerotheca, ou encore Podosphaera. Contrairement à d’autres maladies fongiques qui pénètrent profondément les tissus, l’oïdium reste en surface. Il forme un feutrage blanc ou gris clair, à l’aspect poudreux, visible sur les feuilles, les jeunes tiges et parfois les fruits et les fleurs.
L’une des particularités de l’oïdium est qu’il se manifeste sous forme de tâches circulaires qui s’étendent progressivement sur les deux faces des feuilles. En l’absence d’intervention, la plante touchée montre des signes de stress : feuilles recroquevillées ou desséchées, croissance ralentie, et dans le cas des cultures potagères ou fruitières, une baisse significative du rendement.
Bien qu’il existe de nombreuses espèces d’oïdium, chacune possède un spectre d’hôtes relativement étroit. Cela signifie que le champignon qui affecte les courgettes ne touchera pas forcément les pommiers, et inversement. Toutefois, certaines adventices peuvent héberger différentes souches et favoriser leur dissémination.

Quelles plantes sont touchées par l'oïdium ?
Peu de familles végétales échappent à l’oïdium. Certaines sont particulièrement sensibles :
Au potager : les courgettes , concombres , courges , melons , pois , haricots , choux , radis , épinards ...
Au verger : les pommiers sont parmi les plus fréquemment atteints, ainsi que les groseilliers , cassissiers , groseilliers à maquereau ...
Parmi les plantes ornementales : rosiers , asters , delphiniums , bégonias , azalées , clématites , chênes , lilas ...
Il n’est pas rare de voir apparaître l’oïdium dans des massifs fleuris en fin de printemps ou lors des étés secs, surtout si les plantes sont denses ou si l’air circule mal autour du feuillage.

Dans quelles conditions se développe l’oïdium ?
L’oïdium est une maladie typique des saisons chaudes. Il se manifeste le plus souvent au printemps et en été , lorsque les températures oscillent entre 10 et 30 °C , avec un pic d’activité autour de 25 à 28 °C .
Contrairement à d'autres champignons comme le mildiou qui ont besoin d’humidité libre (pluie, arrosage sur feuillage), l’oïdium préfère les environnements humides mais pas détrempés , et confinés : serres mal aérées, massifs trop denses, ou endroits abrités mais mal ventilés.
Le champignon s’installe à la surface des tissus végétaux et produit des spores très légers, microscopiques, qui se propagent par le vent et peuvent contaminer rapidement d'autres plants à proximité.
Certaines espèces fongiques à l’origine de l’oïdium produisent des spores particulièrement résistantes, qui peuvent infecter les plantes même en conditions relativement sèches. En hiver, ces spores survivent sur les débris végétaux (feuilles tombées, tiges desséchées) et redémarrent leur cycle au printemps suivant.
Quels sont les effets de l’oïdium sur le végétal ?
La présence d’oïdium, même si elle ne détruit pas toujours la plante, a plusieurs conséquences négatives :
Réduction de la photosynthèse : le feutrage blanc empêche la lumière de pénétrer jusqu’aux cellules chlorophylliennes.
Affaiblissement général : la plante s’épuise à lutter contre l’infection.
Déformation des jeunes pousses : notamment chez les rosiers, courgettes, melons...
Apparition de tâches brunes ou dessèchement prématuré du feuillage.
Baisse du rendement pour les cultures potagères et fruitières.
Plus la maladie est prise tôt, plus il est facile de limiter sa propagation et ses conséquences.

Comment prévenir et traiter l’oïdium ?
Choisir des variétés résistantes
De plus en plus de variétés de légumes, notamment de cucurbitacées, sont sélectionnées pour leur résistance partielle ou totale à l’oïdium. Un choix judicieux en amont peut épargner bien des soucis.
Favoriser une bonne aération
Plantez vos légumes à bonne distance pour éviter les microclimats confinés. En serre ou sous tunnel, pensez à aérer régulièrement. Cela limite la stagnation de l’humidité et freine la propagation des spores.
Éliminer les parties atteintes
Dès les premiers signes, supprimez et détruisez les feuilles malades (ne les compostez pas !). En automne, inspectez soigneusement vos plantes et brûlez toutes les parties contaminées pour limiter les risques de réinfection au printemps.
Stimuler les défenses des plantes
Avoir recours aux purins d'ortie, de prêle ou de consoude pour stimuler la défense des plantes et lutter contre l'oïdium.
Les purins, notamment ceux de prêle et d’ortie, sont surtout efficaces en lutte préventive contre le mildiou. Ils renforcent la résistance naturelle des plantes et limitent le développement du champignon avant qu’il ne s’installe vraiment.
Les poudres d’algues ou extraits de laminaire stimulent également la résistance des cultures.
Notre sélection de purins pour lutter contre l'oïdium :
Surveiller régulièrement
Une vigilance hebdomadaire au jardin permet une détection précoce, bien plus facile à gérer qu’une infestation avancée. En cas de doute, isolez temporairement la plante atteinte si cela est possible.